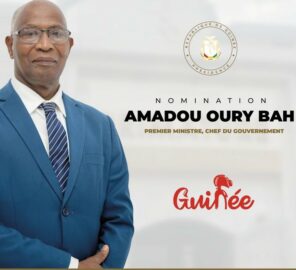L’un des paradoxes les plus frappants de la campagne référendaire en cours réside dans l’incapacité du régime de Transition à convertir ses appuis institutionnels en une force politique tangible et légitime. En s’appuyant sur un aréopage de figures ralliées, issues pour la plupart d’un paysage partisan mis en sommeil, les autorités entendaient-ils reconstruire, à leur profit, une architecture politique amputée de ses piliers historiques ? L’expérience tourne court.
Le pari d’une recomposition par le haut, via l’annexion symbolique d’anciens responsables politiques, s’est heurté à une réalité têtue : l’influence politique ne se décrète pas, elle se cultive dans le temps long, à travers des structures enracinées et des relais organiques. Les soutiens proclamés à la Transition, souvent réduits à des individualités sans troupes, n’ont su qu’alimenter une présence numérique, quand il fallait bâtir une mobilisation physique.
À défaut de campagnes de masse, le pouvoir s’est contenté de scénographies numériques : quelques rassemblements filmés, des slogans recyclés, des photos léchées pour les réseaux sociaux. Une esthétique de la mobilisation qui masque mal la pauvreté du terrain. Loin des foules galvanisées qui faisaient naguère vibrer les grandes artères politiques, ces opérations confinent à la diffusion d’idées de circonstance.
A bien des égards, il serait illusoire d’interpréter le silence des partis suspendus comme un effacement. Si des personnalités ont effectivement fait défection, les appareils, eux, ont résisté. Tués dans le texte, mais vivants dans les faits. En retrait mais non inertes. Les réseaux militants, forgés au fil d’années de luttes électorales et de stratégies territoriales, n’ont pas disparu avec la mise sous cloche administrative. Ils attendent. C’est ce qu’on a constaté.
C’est vrai que l’enjeu du boycott annoncé sera, en ce sens, un révélateur. Si les consignes de non-participation se traduisent par une abstention massive -et à condition, bien sûr, que le scrutin se déroule dans des conditions de sincérité minimales- alors les partis sanctionnés pourraient retrouver un levier d’influence. À l’inverse, une participation significative poserait la question de leur perte d’emprise.
Cette campagne met ainsi en lumière une équation politique instable : un pouvoir sans ancrage partisan, face à des partis privés d’existence légale mais non dénués de souffle. Si les relais offerts par les soutiens nouveaux s’avèrent inconsistants, la Transition sera confrontée à un dilemme fondamental : créer de toutes pièces un parti de gouvernement, ou organiser des élections sans partenaires politiques crédibles. À moins, plus radicalement, de se confronter à un électorat livré à lui-même, et donc, potentiellement, imprévisible.
Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com
L’article Ce qu’on peut retenir de la campagne référendaire est apparu en premier sur Guinee7.com.
Last modified: 18 septembre 2025